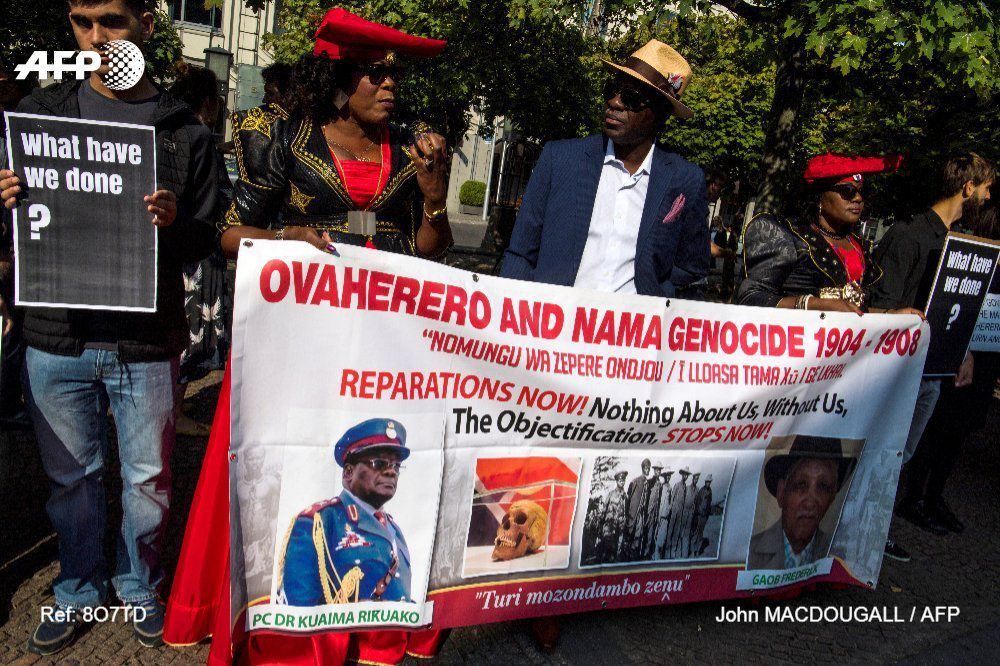Portraits de victimes du génocide
Mise à jour du 28 avril 2021:
Nouvel assaut négationniste des fidèles de Mitterrand. Une partie de ses anciens ministres ( dont Jack Lang et Jean-Luis Bianco) co-signent dans l'Obs une tribune manifestement rédigée par Hubert Védrine, lui aussi signataire. Celle-ci reprend en effet mot pour mot les arguments mensongers déjà présents dans un texte de ce dernier publié sur le site l’Institut François-Mitterrand datée du 2 avril.
Ce plaidoyer prétend s'appuyer sur le rapport Duclert et un rapport dit Muse, issu d'une commande des autorités rwandaises actuelles. Mais ces deux rapports, bien qu'incomplets en raison de l'impossibilité d'accéder à certaines archives, représentent déjà une démonstration éclatante de ce que furent les responsabilités accablantes des autorités de l'époque dans le génocide.
MEMORIAL 98
Il y a 27 ans, jour pour jour, débutaient les 100 jours du
génocide des Tutsi du Rwanda, qui aboutit à la mise à mort d’un million de
personnes.
En cette période de pandémie, les cérémonies organisées par
nos partenaires de Ibuka France se déroulent essentiellement à distance
par Zoom.
Memorial 98 participera ainsi à une table ronde le dimanche 11 avril de 11H à 13 H sur le thème Lutter pour l'universel : mener son combat, ceux des autres et celui de l'humanité .
La commémoration du vingt-septième anniversaire du génocide
des Tutsi est dominée par le débat ouvert sur des responsabilités des autorités
françaises de l’époque. En 2019, lors du
vingt-cinquième anniversaire, Emmanuel Macron fut amené à prendre une
initiative car la chape de plomb qui entourait la mise à jour
des responsabilités françaises était en
train de craquer grâce à la détermination des survivants du génocide et à des
militaires français qui avaient décidé de témoigner.
Il créa donc une commission d’historiens censée
faire la lumière sur la période des années 1990-1994.
La
composition de la commission Duclert (nom de son président) fit l’objet de protestations de la communauté
historienne, après l’annonce de la mise à l’écart de deux des principaux
spécialistes français du sujet : Hélène Dumas seule experte à maîtriser la langue utilisée au Rwanda (kinyarwanda) et Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur d’études à l’EHESS.
Ce
dernier, qui disait avoir été reçu par la cellule Afrique de l’Élysée quelques
jours avant l’annonce, expliquait qu’on lui a laissé entendre que
« certains de [ses] écrits sur le rôle de l’armée française au Rwanda
avaient pesé dans la balance et que [sa] présence serait une source de blocage.
Et ce, après m’avoir expliqué au préalable que mes travaux avaient contribué à
motiver la création de cette commission ».
Le rapport de la commission Duclert, tout juste rendu pointe
un «ensemble
de responsabilités, lourdes et accablantes pour la France ». Mais cette
commission, en attribue la cause à ce qu’elle nomme
l’ « aveuglement » des autorités françaises et exonère les
responsables d’alors d’une complicité dans le déroulement du
génocide.
Or le rapport lui-même prouve
exactement le contraire puisqu’il indique que « La France s’est néanmoins longtemps investie au côté
d’un régime qui encourageait des massacres racistes. Elle est demeurée aveugle
face à la préparation d’un génocide par les éléments les plus radicaux de ce
régime. Elle a adopté un schéma binaire opposant d’une part l’ami hutu, incarné
par le président Habyarimana, et de l’autre l’ennemi qualifié d’“ougando-tutsi”
pour désigner le FPR [Front
patriotique rwandais]. Au moment du génocide, elle a tardé à rompre avec le
gouvernement intérimaire qui le réalisait et a continué à placer la menace du
FPR au sommet de ses préoccupations. Elle a réagi tardivement avec l’opération
Turquoise, qui a permis de sauver de nombreuses vies, mais non celles de la
très grande majorité des Tutsi du Rwanda, exterminés dès les premières semaines
du génocide. La recherche établit donc un ensemble de responsabilités, lourdes
et accablantes. »
Responsables mais pas coupables donc, selon la célèbre formule qui vise à garantir l'impunité de ceux qui ont laissé commettre des crimes, dont il étaient parfaitement avertis et qu'ils pouvaient aisément faire cesser.
Notons que le
« gouvernement intérimaire » qui est mentionné ci-dessus est en fait
le gouvernement génocidaire. Or il a été validé dans les locaux de l’ambassade
de France à Kigali, alors même que les massacres avaient contre les Tutsi déjà
débuté.
Nous soutenons donc l‘appel émouvant et fort
des rescapés rwandais vivant en France ( ci-dessous), qui exigent que des excuses soient
présentées aux victimes et familles endeuillées. Ils refusent à juste titre
l’excuse de « cécité » et d’ « aveuglement » dont
auraient été victimes les autorités française
« En 1994, nous
étions pourchassés, traqués, renvoyés à la condition animale par nos meurtriers
parce que nous étions nés tutsi. Dans ces moments d’immense solitude, envahis
par une peur extrême de mourir découpés à la machette, nous fabriquions des
lueurs d’espoir pour nous accrocher à la vie qui nous échappait à chaque minute
qui passait
Puisque
nous étions convaincus de notre appartenance à la communauté des humains,
beaucoup d’entre nous, jeunes et naïfs, se sont dit que « le monde »
viendra nous secourir dès qu’il saura ! D’autres ont vu très tôt leurs
espoirs s’évaporer en voyant les soldats étrangers trier ceux qui possédaient
les bons passeports pour être évacués. Leur vie et celle de leurs chiens
valaient plus que celle des Tutsi.
De
moins en moins nombreux au fil des jours et des semaines qui passaient,
affamés, trempés jusqu’aux os, lassés, nous avons miraculeusement déjoué la
mort. Personne ne sera venu à notre secours. Personne jusqu’à ce que les
soldats du Front patriotique rwandais (FPR) arrêtent cette mort programmée au
péril de leur vie. Certains d’entre nous pensions jusqu’alors que « le
monde » n’avait pas su. Puis, nous avons compris qu’il avait su mais
s’était tu.
Progressivement, nous avons compris que
l’Etat français en particulier avait choisi le camp de nos bourreaux. Il a
soutenu le régime raciste de Habyarimana qui nous obligeait déjà écoliers à
nous lever pour décliner notre ethnie. Il a soutenu ce régime ségrégationniste
qui nous empêchait par des quotas officiels d’accéder aux études secondaires et
universitaires et qui nous excluait d’office de certains emplois. Il a soutenu
ce régime qui organisait des pogroms contre les Tutsi.
Prétendue cécité
Un
régime qui préparait notre extermination. La France d’alors, dirigée par
François Mitterrand, a soutenu ce Rwanda-là malgré les avertissements de
certains de ses diplomates, de ses chargés de coopération, de la DGSE, des ONG.
De retour du Rwanda, le témoignage émouvant de Jean Carbonare en
janvier 1993 sur le plateau du 20 heures de Bruno Masure n’a rien
changé. Le soutien a été maintenu et poursuivi en faveur d’un Etat qui
commettait le génocide contre nous.
Dès
lors, en tant que rescapés, nous ne pouvons admettre ni croire en « l’aveuglement », terme
utilisé par la commission Duclert pour expliquer les choix des autorités
françaises. Qu’aurait-il fallu de plus pour prévenir cette prétendue
cécité ?
Monsieur
le Président, il y a deux ans, vous avez reçu des membres d’Ibuka France [« Souviens- toi » en kinyarwanda] qui
œuvre pour la mémoire, le soutien aux rescapés et la justice. Suite à cette
rencontre, vous avez décidé d’instituer le 7 avril comme journée
officielle de commémoration du génocide des Tutsi. Une première étape
pour « inscrire le génocide dans
la mémoire collective française », selon vos propres termes et
nous vous en remercions.
Maintenant
que le rapport de la commission d’historiens vous a été livré, nous réclamons
une parole officielle forte pour ces 27es commémorations. Elle
sera protectrice pour parer aux attaques incessantes et blessantes entretenues
par certaines personnalités politiques et militaires. Depuis plus de vingt-cinq
ans, le génocide des Tutsi a été occulté en France par un discours qui
cherchait à minimiser le rôle des responsables français. Après ce rapport, nous
attendons de votre déclaration qu’elle mette fin à ces discours et bannisse la
thèse du double génocide qui a été propagée pour semer volontairement la
confusion.
Rechercher les responsables
Mais
le génocide des Tutsi ne saurait être pleinement inscrit dans l’histoire de
France en l’absence de symboles dans l’espace public. A ce jour, seules
quelques collectivités locales ont créé des lieux de mémoire : Cluny,
Dieulefit, Bègles, Châlette-sur-Loing, Toulouse, Paris et Strasbourg. Il vous
appartient de faire ériger, enfin, un mémorial national et de créer un musée
sur le génocide des Tutsi. Pour être transmise, cette histoire mérite un lieu
de ressource décent pour l’accueillir et la conserver.
Maintenant
que les responsabilités françaises qualifiées de « lourdes et accablantes » ont
été établies, il est temps d’en rechercher les responsables. Et seul le juge
peut le faire à condition d’accéder à toutes les pièces à conviction. Nous ne
comprendrions pas que la justice ne puisse disposer de toutes les archives
disponibles. Nous ne concevrions pas que vous ne fassiez pas tout ce qui est en
votre pouvoir pour que justice nous soit rendue et, ce, de notre vivant.
Monsieur
le Président de la République, nous ne pouvons nous résoudre à disparaître un
jour sans avoir entendu de réelles excuses d’un président français pour nos
enfants innocents, pour nos mères, nos pères, nos frères et sœurs, nos
grands-parents, nos oncles et tantes, nos cousins et cousines, nos meilleurs
amis, tous assassinés dans des conditions inouïes. Loin de la repentance d’un
pays à l’autre, nous vous demandons de le faire pour les victimes, pour les
familles endeuillées, pour les rescapés vivant en France que nous sommes.
Signataires : Jeanne Allaire
Kayigirwa, Valens Kabarari, Lenualda Munyakazi, Adélaïde Mukantabana, Etienne
Nsanzimana, Clotilde Mukamugema, Thérèse Gasengayire, Pamela Gasana, Christelle
Isimbi Ndagijimana, Yolande Umuhoza, Denise Millet Uwamwezi, Janvier Gatari,
Clémence Narambe, Jeanne Uwimbabazi, Jean-Paul Ruta, Olivier Nasagambe, Gilbert
Karamaga, Thierry Ndagijimana, Nasir Rahamatali, Claire Rwabirinda, Evangeline
Zimmerman Kamikazi, Manzi Ndagjimana, Irène Bambe, Yves Rukeratabaro, Hakim
Rahamatali, Anita Cyabakanga, Beatha Uzayisenga, Francine Uwanyirigira,
Sandrine Lorusso, Solange Umulisa, Béatrice Kabuguza, Jean Kalimba kamilindi,
Yvonne Kalimba, Esther Umwali, Angelina Umulisa, Marie-Laure Kayitayire, Stella
Agasingizo, Aurore Mugeni, Clément Rugamba, Emmanuel Rugema, Assoumpta
Kayirangwa, Marie-Amée Karira, Vestine Mukabalisa et Liliane Kanyarutoki."
Un génocide
planifié et préparé.
C'est en effet le 7 avril 1994 que débutèrent au Rwanda les
massacres qui allaient voir la mort d'au moins un million de personnes jusqu'au
mois de juillet de la même année: des
individus définis comme Tutsi, constituant la majorité des victimes, mais aussi
des Hutu opposés aux partisans de l'idéologie raciste dite "Hutu
Power"
D'une durée de cent jours, ce fut le génocide le plus rapide et
concentré de l'histoire et celui de la plus grande ampleur quant au nombre de
morts par jour de tuerie.
Fruit d'une idéologie raciste mise en œuvre sur des décennies, ce
génocide s'est appuyé, pour diffuser la haine, avant et pendant, sur une
agitation raciste incessante, notamment à la Radio Télévision des Milles Collines, mais
aussi sur les caricatures déshumanisantes de la propagande génocidaire .
Comme pour tous les projets génocidaires, celui-ci s'accompagne ensuite
de campagnes négationnistes, de difficultés à faire reconnaître les
responsabilités entre autres les responsabilités françaises et à faire
vivre la mémoire. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'enfin une stèle au Père Lachaise à Paris commémore ce génocide et
encore deux ans ans avant que soit inauguré un Jardin de la Mémoire dans un
parc parisien.
Des progrès limités ont aussi été réalisés dans le domaine de la
justice puisque enfin des génocidaires ont été jugés et condamnés en France.
Ces procès doivent beaucoup à l’action de nos amis du Collectif
des parties civiles pour le Rwanda qui poursuivent un combat
incessant pour que le Parquet et les tribunaux jouent enfin leur rôle. En effet
la justice demeure très partielle, lente et laborieuse, malgré l'arrestation de . Des génocidaires
présumés lui échappent.
Les habitants de nôtre pays ont un devoir particulier en ce qui
concerne le Rwanda. En effet, une partie du combat est aujourd'hui celui de la
pleine reconnaissance par l’État français de ses responsabilités.
Or le pouvoir Hutu extrémiste a reçu de manière continue et
appuyée le soutien des autorités françaises tant au plan politique, militaire
que financier, avant, pendant et après le génocide.
L’entière doit être faite au sujet de cette implication : tous les documents doivent être rendus
publics.
On
est encore très loin du compte dans ce domaine malgré des annonces
retentissantes. La commission Duclert elle-même s’est plainte du caractère
fragmentaire de nombreuses archives en principe mises à sa disposition.
Les
preuves s'accumulent maintenant quant à la participation des pouvoirs publics français
et d’institutions financières (dont la BNP) à l’exécution du crime.
L’attention se concentre
sur Hubert Védrine, qui continue à nier
ses responsabilités et celles de Mitterrand. Ainsi dans une déclaration
de l’Institut François-Mitterrand datée du 2 avril il ose écrire que « C’est ce processus (conduit par la France) que viendra briser le 6 avril 1994 l’attentat
perpétré contre l’avion du Président Habyarimana rentrant d’Arusha, attentat
qui sera suivi d’une nouvelle offensive du FPR et du déclenchement du génocide. » Il implique ainsi que le génocide constitue
une réponse à un attentat et à une offensive dont le FPR serait responsable. Le
négationnisme est ici avéré.
A
ce moment (1993-1995) Mitterrand était président et Balladur chef d’un
gouvernement de cohabitation, suite aux élections de 1993. Hubert Védrine,
secrétaire général de la présidence, jouait un rôle capital et bénéficiait de
l’entière confiance du président.
Mitterrand et Védrine étaient particulièrement
complaisants à l’égard des chefs Hutu, considérés comme favorables à la
France car francophones, alors que les dirigeants Tutsi, qui avaient dû se
réfugier en Ouganda étaient considérés comme favorable au monde anglophone.
De plus Mitterrand
défendait la thèse négationniste du « double génocide », selon lequel
les torts étaient partagés entre génocidaires et victimes. Ainsi après le
sommet franco-africain de Biarritz en 1994, il lance à un journaliste qui l’interroge :
“De quel génocide parlez-vous, monsieur ? De celui des Hutus contre les
Tutsis ou de celui des Tutsis contre les Hutus ? ”
Védrine a de son côté défendu l’auteur
négationniste Pierre Péan en 2008 ( décédé depuis) lors
du procès de ce dernier après la parution de son livre sur le
Rwanda « Noires fureurs, blancs menteurs ». Le
déroulement de ce procès démontre les ressorts et arguments des négationnistes,
si proches de ceux qu’on retrouve dans des cas semblables (lire ici le
compte rendu qu'en fit Memorial 98)
C’est dans cette sphère du déni qu’avait aussi agi le juge
« anti-terroriste » Jean-Louis Bruguière chargé d’une enquête
sur l’attentat qui le 6 avril 1994, toucha
l’avion transportant le président du Rwanda Habyarimana, abattu par deux
missiles à son approche de l’aéroport de la capitale Kigali.
Bruguière conclut, au terme d’une enquête
partiale conduite depuis Paris, sans déplacement sur les lieux de l’attentat, à
la responsabilité des rebelles tutsi (FPR) ; il lança des mandats d’arrêt
internationaux contre de hauts responsables du FPR au pouvoir à Kigali.
Suite aux conclusions du rapport
Bruguière, les thèses négationnistes se renforcèrent et obtinrent une sorte de
droit de cité dans le discours public, notamment français. L’attribution au FPR
de la responsabilité de l’attentat du 6 avril a servi à protéger des
questions embarrassantes les dirigeants politiques de cette époque de
cohabitation : Mitterrand,
Balladur, Léotard, Juppé, Roussin, Hubert Védrine, les
responsables militaires et tous les officiels ayant joué un rôle dans la
complicité militaire, politique, diplomatique et financière de la France dans
le génocide.
Bruguière, parti à la retraite avant une
carrière politique dans les rangs de l’UMP, son successeur, le magistrat anti-terroriste Marc Trévidic se rendit à
Kigali en 2012, ce que n’avait jamais fait Bruguière, et aboutit à
des conclusions totalement inverses sur le déroulement de qui allait constituer
le prétexte de la mise en œuvre du crime.
C’est pourquoi nous soutenons et partageons pleinement le
combat de nos amis et partenaires de Ibuka-France Mémoire, du CPCR et de Survie
afin que la vérité se fasse jour et que les coupables éventuels soient jugés.
On notera que Védrine est toujours présent sur la scène politique et
médiatique. Il semble qu’il soit écouté par Macron. Il
serait même à l’origine du tournant consistant à s'allier avec Bachar El Assad sous
prétexte de « lutter contre le terrorisme » alors que Assad en
est le principal responsable et parrain. Védrine a aussi beaucoup de sympathie
« réaliste » envers Poutine.
Dans ce domaine de la responsabilité des États la justice des Pays-Bas a émis un verdict historique, bien
qu'incomplet et frustrant. Elle juge que les autorités de son pays ont laissé
se dérouler le génocide de Srebrenica ( en juillet 1995, un an à peine après celui des Tutsi),
sans permettre le sauvetage des personnes qui tentaient de se réfugier dans
l'enclave des Casques Bleus néerlandais présents sur place. C'est le résultat
d'une longue bataille des victimes et de leurs avocats avec le soutien d'ONG
néerlandaises et internationales, mobilisées pour la justice et contre
l'impunité.
Cette reconnaissance est importante car elle
trace la responsabilité des gouvernements qui laissent se dérouler des
génocides et crimes contre l'humanité et n'interviennent pas pour sauver des
vies humaines. C’est dans le même sens que nous devons agir afin que soit levée
la chape de plomb de la dissimulation au nom de la raison d’État.
En effet, à l’inverse, l'impunité des auteurs
des génocides et massacres représente un facteur évident de récidive et de
perpétuation des actes génocidaires. On se souvient notamment du propos
de Hitler trouvant un encouragement dans la
manière dont le génocide arménien de 1915 était nié :
« Mais qui se souvient encore du massacre des
Arméniens ? » déclarait-il dans une allocution aux commandants en chef de
l'armée allemande le 22 août 1939, quelques jours avant l'invasion de la
Pologne.
C'est pourquoi, plus que jamais et en permanence, la mémoire des génocides nourrit nos
combats.
Le génocide des Tutsi est également le récit d'une horreur
absolue, dans laquelle des voisins massacrent ceux qu'ils connaissent et
fréquentent. Des victimes supplient qu'on les tue avec une arme à feu
afin d'échapper à la machette et au gourdin mais pour cela les massacreurs
exigent qu'ils payent le le prix de la balle. De manière croissante des livres
et témoignages rendent compte de ces atrocités. Les femmes subirent un sort
particulier avec les très nombreux viols et tortures particulières. Les
survivantes luttent pour leur dignité et se regroupent comme celles
de la maison de Kigali qui ont écrit le récit de leurs souffrances et de
leurs combats.
C'est un
immense champ de mémoire et de solidarité qui est en train de s'ouvrir et
auquel nous appelons à participer, pour que justice soit faite.
Nous poursuivrons ce
combat, avec nos amis d’Ibuka et de toutes celles et ceux qui veulent combattre
le négationnisme et faire éclater la vérité.
Voir d’autres textes
et dossiers de Memorial 98 sur le génocide des Tutsi:
http://info-antiraciste.blogspot.com/2019/04/genocide-des-tutsi-au-rwanda-le.html ( le tournant du 25e anniversaire et la contre-offensive de Védrine appuyé par d'anciens ministres socialistes)
http://info-antiraciste.blogspot.com/2020/05/genocide-des-tutsi-lorganisateur-et.html
sur les génocidaires qui ont trouvé refuge en France
https://info-antiraciste.blogspot.com/2020/04/genocide-des-tutsi-au-rwanda-un-26e.html
MEMORIAL 98
Nous reproduisons
ci-dessous des extraits du rapport de la Commission Duclert publiés dans la
pres
« La crise rwandaise s’achève en désastre pour le Rwanda, en
défaite pour la France, écrivent-ils.
La France est-elle pour autant complice du génocide des Tutsi ? Si l’on
entend par là une volonté de s’associer à l’entreprise génocidaire, rien dans
les archives consultées ne vient le démontrer. La France s’est néanmoins
longtemps investie au côté d’un régime qui encourageait des massacres racistes.
Elle est demeurée aveugle face à la préparation d’un génocide par les éléments
les plus radicaux de ce régime. Elle a adopté un schéma binaire opposant d’une
part l’ami hutu, incarné par le président Habyarimana, et de l’autre l’ennemi
qualifié d’“ougando-tutsi” pour désigner le FPR [Front patriotique
rwandais]. Au moment du génocide, elle a tardé à rompre avec le gouvernement
intérimaire qui le réalisait et a continué à placer la menace du FPR au sommet
de ses préoccupations. Elle a réagi tardivement avec l’opération Turquoise, qui
a permis de sauver de nombreuses vies, mais non celles de la très grande majorité
des Tutsi du Rwanda, exterminés dès les premières semaines du génocide. La
recherche établit donc un ensemble de responsabilités, lourdes et
accablantes. »
La
commission rappelle que « les autorités françaises ont fait preuve d’un
aveuglement continu dans leur soutien à un régime raciste, corrompu et violent,
pourtant conçu comme un laboratoire d’une nouvelle politique française en
Afrique, introduite par le discours de La Baule », prononcé
en juin 1990 par François Mitterrand. Pourquoi ce soutien ? L’analyse
est faite depuis longtemps.
Après
son indépendance en 1962, faisant suite à la domination belge, le Rwanda a
développé une grande proximité avec la France. Juvénal Habyarimana, arrivé au
pouvoir en 1973, et François Mitterrand vont nouer une vraie connivence,
qui se manifeste notamment par un appui aux Forces armées rwandaises (FAR).
Déclenchée en octobre 1990, l’opération Noroît a officiellement pour
mission de protéger les ressortissants français au Rwanda face à l’offensive du
Front patriotique rwandais (FPR). Des violences ciblent déjà les Tutsi et
l’opposition, des appels à la délation sont lancés, des exécutions ont lieu.
La
France prétend proposer une relation transactionnelle : un soutien
politique et militaire au régime, seul légitime pour Paris car représentant la
majorité hutu, en échange d’une démocratisation bien improbable.
L’« ennemi » tutsi, lui, est qualifié de menace étrangère, de
guérilla extérieure. Cette présentation va servir pendant quatre ans à
délégitimer le FPR, qui ne serait qu’une excroissance de l’Ouganda anglophone.
Ce qui est en jeu, c’est à la fois la défense d’un régime ami, et celle de la
francophonie, de la zone d’influence française.
«
La commission a démontré l’existence de pratiques irrégulières
d’administration, de chaînes parallèles de communication et même de
commandement »
Alors
que le cercle des extrémistes hutu autour du président Habyarimana est
identifié très tôt par le colonel René Galinié, attaché de défense à Kigali, le
soutien au dirigeant rwandais demeurera jusqu’au bout inconditionnel. Le Front
patriotique rwandais, lui, est présenté comme « un parti manipulateur,
insincère, faussement politique et national », « ethnique et
étranger », bref « un ennemi de la France », selon le
rapport Duclert. « Fortement investie au Rwanda à partir
d’octobre 1990, la France adopte la vision racialiste sans réaliser la
contradiction qu’elle installe avec le projet de démocratisation »
qu’elle prétend promouvoir en appuyant les accords d’Arusha, entre pouvoir et
opposition.
La
coopération militaire avec le régime hutu est si étroite que ce dernier
continue, après le déclenchement du génocide, à réclamer des armes à la France,
comme une évidence, un partenariat indéfectible. Une fiche de la Direction du
renseignement militaire (DRM), en date du 15 avril 1994, « fait
remonter des demandes précises de munitions et d’aide au transport d’armements
achetés en Israël et en Pologne », formulées par l’attaché de défense
de l’ambassade du Rwanda à Paris.
« La réponse apportée n’est pas connue », reconnaît la commission. Les archives étant très
parcellaires, « il est impossible de rendre compte avec certitude de
l’existence de flux d’armes transitant de la France vers le Rwanda » après
le 7 avril. Mais, le 25, une nouvelle demande rwandaise de fourniture
d’armements est signalée, dans une note du Quai d’Orsay. Sur cette question
très sensible, aux nombreuses zones grises, les historiens atteignent les
limites de leur exercice.
« L’ordre
par la voix »
L’une
des occurrences importantes dans le rapport est le mot « parallèle »,
comme hiérarchie ou circuit parallèle. La confiscation du dossier rwandais par
François Mitterrand est allée jusqu’à un contournement des ministères et des
administrations figurant dans les chaînons habituels de la prise de décision. « La
commission, écrivent les historiens, a démontré l’existence de pratiques
irrégulières d’administration, de chaînes parallèles de communication et même
de commandement, de contournement des règles d’engagement et des procédures
légales, d’actes d’intimidation et d’entreprises d’éviction de responsables ou
d’agents. » Derrière la façade démocratique et institutionnelle de
l’Etat français se dessinent des pratiques qui ne relèvent ni de l’une ni de
l’autre.
« L’implication très grande des militaires français dans la
formation des Forces armées rwandaises », d’octobre 1990 jusqu’au génocide d’avril 1994, et la
transformation de ce pays africain en « laboratoire » – autre
occurrence du rapport – portent la marque personnelle du président. Le
secrétaire général de l’Elysée est alors Hubert Védrine. Il lit tout, annote souvent
de quelques mots secs, organise la circulation de l’information. Il veille à la
mise en musique des directives présidentielles. « A chaque moment de
crise, une note vient radicaliser les options, cliver les situations »,
dit le rapport, au sujet de la remontée des écrits des conseillers, civils et
militaires, sur le Rwanda.
En
principe, l’état-major particulier répond directement devant le président. Il
n’a pas de fonction opérationnelle, en dehors de la dissuasion nucléaire. « Le
dossier rwandais démontre l’inverse », note le rapport, qui insiste
sur une pratique du pouvoir opaque : « L’ordre par la voix »,
qui ne laisse pas d’empreintes. Il « pose incontestablement
problème », car il « transfère sur l’exécutant (…) la
paternité de la décision ».
Les
archives exhumées par la commission sur ce point sont surtout signées par le
général Jean-Pierre Huchon, adjoint au chef d’état-major particulier auprès de
l’amiral
Jacques Lanxade puis du général Christian Quesnot. L’emprise de l’EMP
s’exerce sur toutes les administrations, et même à l’Elysée, sur les conseillers
de la cellule Afrique, où Bruno Delaye a remplacé Jean-Christophe Mitterrand.
C’est le syndrome de la pièce close enfumée. Même ceux qui ne tirent pas sur
une cigarette en véhiculent l’odeur.
« Des
pratiques d’officine »
Le
général Huchon envoie des courriers directement « à des agents de
l’Etat aux fins de les influencer voire d’exiger d’eux un alignement sur la
politique élyséenne ». Même chose sur le terrain, au Rwanda. Le
rapport évoque notamment « une collection de télécopies adressées
confidentiellement, et toujours hors circuit officiel, à l’attaché de défense à
Kigali ». Dans certains cas, il lui est demandé instamment de les
détruire sur le champ. D’où le manque d’archives complètes dans ce domaine
sensible. Un grand nettoyage a été opéré.
L’état-major
particulier du président de la République « exerce un pouvoir direct et
permanent sur l’engagement militaire français au Rwanda, jusqu’à ses aspects
matériels et opérationnels »
Objectif
de ces envois : s’assurer de la conversion du colonel René Galinié, sur le
terrain, à la grille de lecture idéologique promue par l’Elysée. En
octobre 1990, celui-ci est conseiller militaire et politique officieux du
régime rwandais. Il rencontre le président Habyarimana à quatre reprises en
huit jours. Ce qu’exige le général Huchon du colonel Galinié « pourrait
s’apparenter à des pratiques d’officine », explique le rapport. Il lui
demande ainsi, dans un fax du 27 octobre 1990, d’organiser une « manipulation
(…) que l’on peut qualifier d’“intoxication” », résument les
historiens. Il s’agit d’inventer, de brandir des « preuves »
(les guillemets autour du mot figurent dans le fax lui-même) de l’emprise de
l’Ouganda anglophone sur l’offensive lancée par le FPR. Si l’opinion
internationale était convaincue de l’existence d’une agression extérieure,
alors l’intervention militaire française en serait légitimée.
Mais
le rôle de l’état-major particulier dépasse largement la coordination et la
partition idéologique. L’EMP « semble s’être transformé en acteur
direct du dossier rwandais, au moyen de pratiques irrégulières », sous
l’approbation du président, « marginalisant de fait les institutions
légalement en charge du commandement opérationnel, l’état-major des armées et
la mission de coopération militaire. » La situation est sans
précédent. L’EMP « exerce un pouvoir direct et permanent sur
l’engagement militaire français au Rwanda, jusqu[e dans] ses aspects
matériels et opérationnels ».
L’Elysée en
liaison téléphonique directe
L’année
1991 est celle du développement des « liaisons parallèles ».
Sont alors mis en place « des dispositifs de communication entre les
unités sur le terrain, c’est-à-dire le DAMI
“Panda” [Détachement d’assistance militaire et d’instruction], armé
par les opérateurs du 1er RPIMa, et une chaîne de commandement qui
apparaît au premier regard polycéphale ». Le rapport cite notamment un
fax du 26 juillet 1991, envoyé de Ruhengeri, une ville du nord du
Rwanda, par le chef du DAMI « Panda ».
Il
fait mention de deux types de liaisons, radioélectriques et téléphoniques,
chiffrées et cryptées, qui relient le détachement à l’opération Noroît,
également au Rwanda, et à une double tutelle à Paris : le ministère de la
coopération et l’état-major des armées. Puis, entre juillet et
octobre 1991, la liaison avec la mission militaire de coopération « disparaît
au profit de l’Elysée, à savoir l’EMP ». L’Elysée se trouve donc en
liaison téléphonique directe avec les soldats français déployés auprès des
Forces armées rwandaises. A notre époque, la sophistication des communications
permet tout, y compris un dialogue par messagerie instantanée entre chefs
d’Etat. Mais, il y a vingt-sept ans, la mise en place d’un tel dispositif était
chargée de sens politique et opérationnel.
«
Le danger est grand, pour la France, […] de passer pour complice de l’actuel
gouvernement rwandais », met en garde la DGSE dans une note du 11 mai 1994
Autonomie
et surveillance, opacité. Tout cela, Pierre Joxe le met en cause. Début
février 1993, le ministre de la défense – rare homme politique dont les
positions de principe républicaines sont saluées dans le rapport – propose une
réorganisation de la prise de décision militaire. Il s’agit de revenir à une
pratique plus conventionnelle et normée. Les comités restreints de défense
qu’il envisage doivent permettre, selon les historiens, « de réformer
des pratiques d’opacité, de communication orale, et des phénomènes de
déresponsabilisation tant politique qu’administrative, qu’il constatait
particulièrement sur le dossier rwandais ». Joxe propose ainsi à
Mitterrand de « préserver le pouvoir présidentiel » sur la
défense, alors que la cohabitation se profile. Il réclamera un enregistrement
écrit des propositions faites au président, des objectifs visés et des
décisions prises. En vain.
De rares
voix divergentes
Au
sein de l’appareil d’Etat, la dissidence n’est pas de mise par rapport à la
ligne décidée à l’Elysée. Pourtant, dès octobre 1990, sous l’autorité du
ministre Jean-Pierre Chevènement, le Secrétariat général de la défense
nationale (SGDN) émet une note sur les « limites de l’engagement
français ». En réponse à l’offensive du FPR de Paul Kagamé, les
300 hommes de l’opération Noroît viennent d’être déployés trois semaines
plus tôt. Le document souligne les intérêts « très limités »
de la France sur place et suggère que Habyarimana, pour sauver son régime,
risque de « relancer les vieilles rivalités en appelant à une sorte de
“guerre sainte” contre les Tutsi ». L’analyse est transmise à
l’Elysée. Sans effet aucun.
Le
rapport Duclert relève, au cours de ces quatre années, d’autres écrits
divergents. Comme l’ont déjà montré de nombreux articles et ouvrages, la DGSE
se distingue par une approche nuancée. Une forte tension traverse ses notes,
qui essaient de tout concilier, la doctrine et la réalité, l’obéissance et la
droiture. Elle relativise fortement, pendant ces années, le soutien apporté par
l’Ouganda au FPR. A plusieurs reprises, elle souligne l’absence d’éléments
tangibles allant dans ce sens. En outre, le service « renvoie une image
critique » de Habyarimana, doute de sa volonté de démocratisation.
Après
le 6 avril 1994 et l’attentat
contre l’avion du président rwandais, très vite la DGSE met en cause les
responsables génocidaires : « Munies de listes préétablies, les
militaires de la garde présidentielle ont entrepris de massacrer tous les
Tutsi, ainsi que les Hutu originaires du sud ou soutenant les partis
d’opposition. » Dès le 2 mai, elle estime que le FPR est « très
certainement étranger » à l’attentat. Le 11 mai, le service
affirme que le pouvoir paraît être « entièrement sous la coupe de la
faction hutu la plus extrémiste ». Puis, à l’aube de l’opération
Turquoise, le service dit : « Le danger est grand, pour la France,
[…] de passer pour complice de l’actuel gouvernement rwandais ».
« L’approche
générale oscille entre la minimisation des faits ou tout simplement un silence
complice », dit la commission
Mais
toutes ces subtilités d’analyse, nourries par les faits relevés sur le terrain,
ont été délibérément ignorées par l’Élysée. Globalement, note le rapport, « la
lecture ethniciste du Rwanda domine », ainsi qu’un soutien à « un
régime raciste, corrompu et violent ». Les faits clairement établis et
les noms des coupables, lorsque les tueries de masse sont déclenchées, « n’apparaissent
pas toujours clairement » dans les télégrammes et les rapports envoyés
à Paris. Nommer la réalité sans verres idéologiques correcteurs obligerait
l’Etat à remettre en cause sa stratégie, ses analyses, son engagement. « L’approche
générale oscille entre la minimisation des faits ou tout simplement un silence
complice », dit la commission.
Ceux
qui contestent cette vision – cette « minorité d’hommes libres »,
auxquels les historiens rendent un hommage appuyé – sont écartés ou mal notés,
comme le rédacteur du Quai d’Orsay Antoine Anfré, ou le général Jean Varret,
chef de la mission militaire de coopération jusqu’en avril 1993. De la
même façon, lors des retours sur expérience et autres analyses commises à
partir du second semestre 1994, l’autocritique est peu en cour. La grille d’analyse
de l’Elysée l’emporte, face aux révélations qui émergent.
MEMORIAL 98